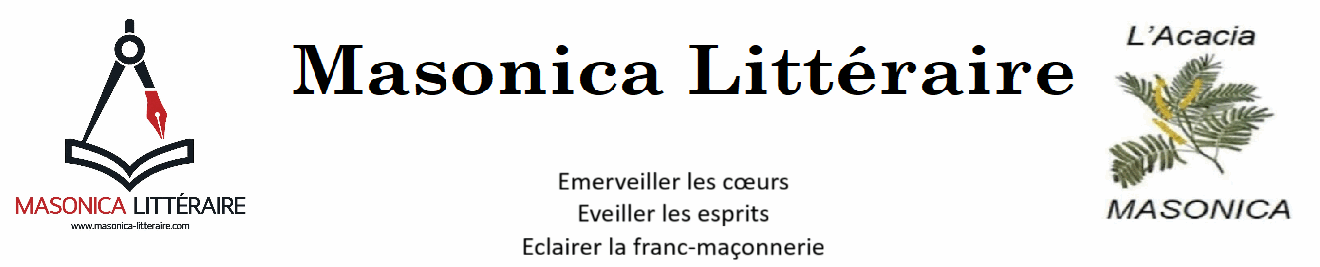L’art médiéval comme théologie
Éric Palazzo
Presses Universitaire de Rennes, coll. Épures, 2025, 128 pages, 10 €
Dans l’ouvrage L’art médiéval comme théologie, Éric Palazzo ne se contente pas de parcourir l’histoire des images ; il en ranime le souffle, en exhume la vibration sacrée, en déploie le regard immémorial. Ce livre court mais dense, comme une fresque resserrée sur un tympan de cathédrale, nous convie à entrer non seulement dans l’intelligence des formes, mais dans la chair même de la foi médiévale – là où l’art devient non plus illustration du dogme, mais incarnation du divin, manifestation du mystère, révélation d’une théologie qui s’écrit autant en lumière qu’en parole, autant en pierre qu’en encre.
Éric Palazzo, historien de l’art médiéval, spécialiste internationalement reconnu de la liturgie et des rapports entre art et spiritualité au Moyen Âge, poursuit ici une œuvre exigeante qui irrigue depuis plus de trente ans la pensée symbolique chrétienne. Directeur de recherches au CNRS, professeur invité à Yale et auteur de nombreux ouvrages sur la théologie visuelle, il est notamment l’auteur du magistral L’Invention chrétienne des cinq sens dans la liturgie et l’art au Moyen Âge (Gallimard, 2014). Mais ce nouveau volume, plus bref, se distingue par une sobriété limpide et une force méditative. Il ne s’adresse pas aux seuls spécialistes : il parle à toute âme désireuse de voir à travers l’image, d’entendre sous la pierre, de sentir dans le vitrail un passage vers l’invisible.
D’entrée, une inversion méthodologique subtile s’opère. Il ne s’agit pas d’appliquer à l’art médiéval des grilles de lecture modernes, mais de tenter de penser avec lui, depuis l’intérieur de sa propre logique symbolique, depuis sa visée théologique. Ce n’est pas l’art « au service » de la foi qui nous est présenté, mais l’art comme foi, comme langage proprement théologique, au même titre que la liturgie, que l’Écriture, que la prière. Une œuvre médiévale ne « représente » pas Dieu : elle en actualise la présence. Elle ne se contente pas d’être belle : elle est une médiation, une voie anagogique, un chemin vers la Jérusalem céleste.
Dans cet horizon, chaque œuvre étudiée devient un locus theologicus, un lieu de théologie visuelle, un témoin de la manière dont l’Occident chrétien a compris la beauté comme participation à la lumière divine. Ainsi la « Belle Verrière » de Chartres n’est pas seulement une prouesse technique ou esthétique ; elle est un sacrement de la lumière incréée. Le tympan de Vézelay ne donne pas seulement à voir la Pentecôte : il en fait vibrer la dynamique cosmique. Le linteau d’Ève, le peigne liturgique, le vase de Suger, chacun de ces objets, par-delà leur matérialité, ouvre sur un au-delà de sens, une théologie incarnée dans la matière, une spiritualité rendue tactile.
Le parcours proposé par Éric Palazzo nous engage aussi à réentendre les voix des grands penseurs du Moyen Âge : Raban Maur, Giraud de Barri, Suger, mais aussi les critiques comme Bernard de Clairvaux. Chacun, à sa manière, éclaire la complexité du rapport au visible : tension entre dépouillement et ornement, entre silence et magnificence, entre l’ascèse cistercienne et l’élévation gothique. Mais c’est surtout la figure de Suger qui traverse le livre comme un astre central : en redonnant à l’art la puissance d’un vecteur d’élévation spirituelle, il introduit cette idée décisive que la contemplation esthétique peut conduire à la contemplation eschatologique, et qu’en ce sens, toute église est déjà un avant-goût du Royaume.
Ce que nous découvrons ici, c’est que l’art du Moyen Âge est une parole. Non une parole muette, mais une parole autre, qui parle par la couleur, par la forme, par la lumière, par le geste. Une parole qui ne s’oppose pas au texte mais le prolonge, le précède parfois, le double toujours. L’image n’est pas inférieure à l’écrit, elle n’est pas une aide pour les simples, comme on le dira plus tard à tort. Elle est une forme de révélation en soi, une modalité propre de la Parole incarnée. Et c’est là que le lien avec la démarche maçonnique devient, pour nous, éclatant… car dans l’Art Royal aussi, le symbole n’est pas un simple outil pédagogique. Il est opératif, agissant, transmutatif. Il ne signifie pas, il agit. Comme le vitrail illumine le sanctuaire, la parole symbolique illumine l’âme.
Dans cette perspective, L’art médiéval comme théologie n’est pas un livre seulement érudit. Il est un seuil. Un passage. Une convocation intérieure. Il nous rappelle que nous sommes appelés à voir autrement, à penser autrement, à ressentir autrement. Que la Beauté n’est pas accessoire à la vérité, mais son éclat, sa trace, sa mémoire.
Ce que nous offre Éric Palazzo, c’est la possibilité de retrouver une écoute sensible et fraternelle de l’image. Une écoute qui n’analyse pas seulement, mais qui s’agenouille, qui contemple, qui laisse advenir. À l’heure où le sacré semble s’effacer dans le bruit du monde, où le visible est réduit à l’utile, où la contemplation recule devant la consommation, ce petit livre murmure doucement une immense leçon. Il est donc encore possible de voir avec l’âme. Il est encore possible d’entendre la parole sous la pierre. Il est encore possible de bâtir un temple intérieur, orné non d’or ni de marbre, mais de lumière, de silence, de beauté partagée.
Et peut-être, alors, en franchissant le porche de cette cathédrale invisible qu’est l’œuvre d’art, comprendrons-nous que nous sommes tous, d’une certaine façon, des bâtisseurs du divin.