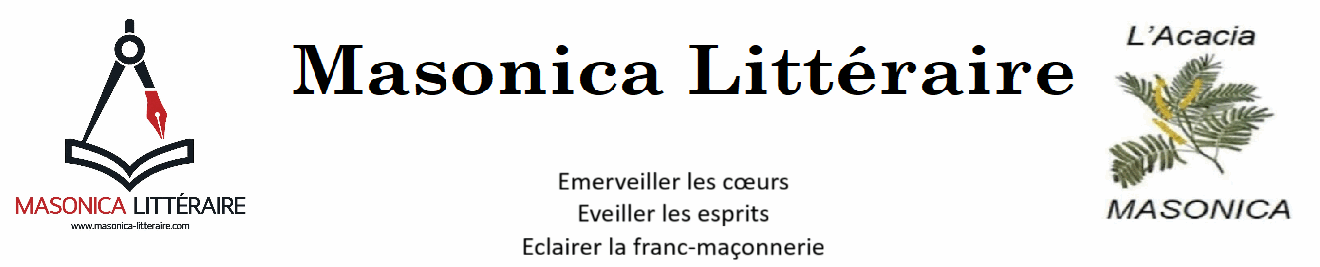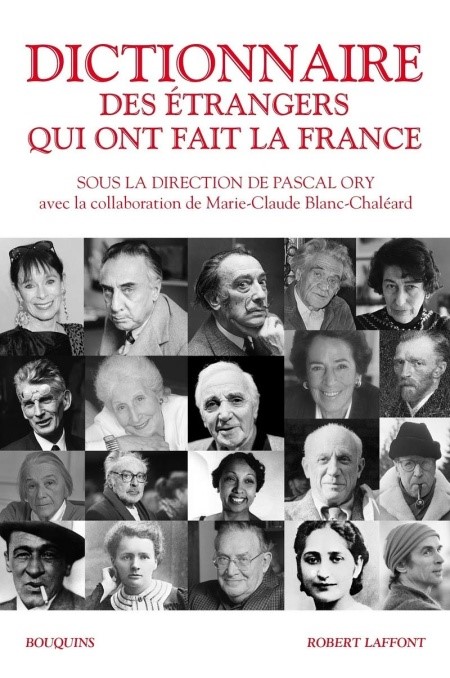
Le Titre : Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France
Auteur : Pascal Ory (dir.), avec la collaboration de Marie-Claude Blanc-Chaléard
Edition : Bouquins/Rober Laffont,
2013, 992 pages
Le Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, dirigé par Pascal Ory avec la collaboration de Marie-Claude Blanc-Chaléard, est un hommage essentiel à ceux dont l’histoire personnelle et collective a façonné la France dans sa diversité. Ce dictionnaire se veut un pont historique, célébrant la richesse culturelle et sociale apportée par des étrangers devenus, par leurs talents et leurs actes, des acteurs incontournables de l’identité française. Dans cette œuvre, chaque notice, qu’elle soit individuelle ou collective, renvoie à une multitude de parcours uniques, certains plus connus que d’autres, mais tous ayant contribué à construire l’image de la France.
Parmi les personnalités qui émergent de ces pages, certaines, comme Marie Curie, Pablo Picasso, Frédéric Chopin, ou encore Joséphine Baker, symbolisent un apport culturel qui transcende les frontières. Cependant, Ory et ses contributeurs vont au-delà de ces icônes, s’attachant à révéler des figures plus discrètes dont le rôle dans les arts, la politique, les sciences, et même l’économie est tout aussi précieux pour le patrimoine français. Les immigrants anonymes qui ont modelé la France à travers des métiers modestes mais cruciaux, du mineur polonais au maçon portugais, sont également salués, illustrant la dimension collective et souvent invisible de l’immigration.
L’ouvrage ne se limite pas à un catalogue de contributions individuelles, mais révèle des dynamiques historiques, politiques, et sociales. Il démontre que la France, loin de son mythe d’unité pure, a toujours été marquée par des apports extérieurs, qu’il s’agisse d’idées, de talents ou d’innovations. Le dictionnaire montre que cette interaction entre la nation et les apports étrangers a commencé bien avant les vagues modernes d’immigration, dès les invasions et alliances médiévales, pour se cristalliser avec la Révolution française, véritable acte fondateur de l’inclusion dans le corps national.
Les choix éditoriaux sont particulièrement révélateurs d’une vision inclusive. En insistant sur l’intégration de communautés entières (les Arméniens, les Polonais, les Vietnamiens, etc.), Ory met en lumière une France plurielle, où chaque contribution renforce l’idée d’un creuset français unique, à la fois distinct du melting-pot américain et de la simple juxtaposition de cultures. Les notices évoquent la capacité française à assimiler les différences, illustrant comment ce creuset a transformé les étrangers en citoyens, souvent avec une rapidité remarquable.
Ory aborde aussi les tensions inhérentes à cette transformation. L’antisémitisme de Vichy, les mouvements xénophobes et les lois restrictives contrastent avec la tradition d’accueil qui a permis à la France d’incarner une terre de refuge, un lieu où la liberté, la culture, et les droits de l’homme attirent intellectuels et artistes persécutés. Cette ambivalence nationale, où l’ouverture cohabite avec le rejet, est saisie avec acuité dans l’ouvrage, qui laisse place à une critique implicite mais présente de l’amnésie collective face aux apports étrangers.
Enfin, ce dictionnaire, dans sa structuration et son ambition, propose une lecture au-delà des noms et des parcours ; il invite à une méditation sur l’identité française elle-même. Loin de se diluer, celle-ci s’enrichit dans l’interaction, se redéfinissant sans cesse au gré des vagues d’immigration. Cette œuvre érudite et profondément humaniste est une réflexion collective sur ce que signifie « faire la France », à la fois pour les natifs et pour ceux qui, en y apportant leur singularité, y inscrivent leur destinée.